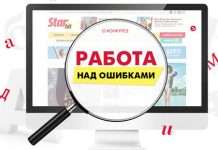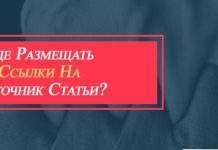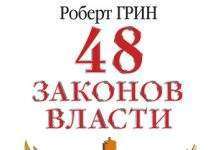Un nombre croissant de personnes choisissent de s’abstenir de l’intelligence artificielle (IA) générative – des systèmes comme ChatGPT et des générateurs d’images – pour des raisons éthiques, environnementales et même cognitives. Surnommé « AI vegans » par certains, ce mouvement reflète des inquiétudes plus profondes quant à l’intégration rapide de l’IA dans la vie quotidienne et à ses conséquences potentielles.
Les préoccupations éthiques : vol, exploitation et consentement
L’argument principal contre l’IA générative repose sur sa dépendance à l’égard de vastes ensembles de données extraits d’œuvres créatives existantes. De nombreux artistes, écrivains et musiciens estiment que leur propriété intellectuelle est exploitée sans consentement. Comme l’a dit Bella, une artiste tchèque, utiliser l’IA ressemble à une « trahison » après des années passées à perfectionner ses compétences.
L’éthique s’étend au-delà du droit d’auteur. Marc, un abstentionniste espagnol en matière d’IA, considère l’IA générative comme un outil d’« exploitation ouvrière », arguant qu’elle perpétue les systèmes capitalistes au détriment de la créativité humaine. Ces inquiétudes ne sont pas sans fondement : la formation des modèles d’IA repose souvent sur des étiqueteurs de données sous-payés, en particulier dans des pays comme le Kenya, ce qui soulève des questions sur les pratiques de travail équitables.
Impact environnemental : un coût caché
Au-delà des implications morales, l’IA générative a une empreinte environnementale importante. Même une courte conversation avec ChatGPT peut consommer l’équivalent d’une bouteille d’eau, selon une étude de 2023. Cette demande énergétique s’ajoute à l’empreinte carbone déjà importante des centres de données, rendant l’IA moins durable que beaucoup le pensent.
Effets cognitifs : dépendance et diminution de la pensée
De nouvelles recherches suggèrent que l’IA pourrait également nuire au développement cognitif. Une étude récente du MIT a révélé que les participants qui utilisaient ChatGPT pour rédiger des essais démontraient un engagement cérébral moindre et avaient du mal à se souvenir de leur propre travail. Nataliya Kosmyna, co-auteure de l’étude, prévient que cela pourrait éroder l’appropriation des idées et compromettre les performances dans des situations à enjeux élevés.
Cette dépendance à l’égard de l’IA pour des solutions rapides fait craindre un déclin des capacités de pensée critique. Lucy, une autre abstentionniste de l’IA, craint que les chatbots renforcent les idées délirantes en fournissant une validation constante, ce qui pourrait exacerber les problèmes sociétaux existants.
Les défis de l’abstinence
Il devient de plus en plus difficile d’éviter l’IA à mesure qu’elle imprègne les lieux de travail, les écoles et les médias sociaux. Marc, ancien professionnel de la cybersécurité de l’IA, décrit la pression pour l’utiliser à l’université et la « dépendance à la simplification » parmi les membres de sa famille. Lucy est confrontée à des défis similaires lors de son stage de conception graphique, où les clients exigent du contenu généré par l’IA malgré ses défauts.
L’avenir de l’IA : réglementation contre interdiction
Pour certains, comme Marc, la solution est l’interdiction pure et simple. D’autres plaident en faveur de réglementations plus strictes donnant la priorité à un approvisionnement éthique et à des pratiques de travail équitables. Kosmyna estime que l’IA générative devrait être interdite aux mineurs et non imposée aux étudiants dans les établissements d’enseignement.
En fin de compte, le mouvement « AI vegan » souligne la nécessité d’une prise en compte attentive des impacts sociétaux de l’IA. Alors que certains voient ses avantages potentiels, d’autres choisissent de s’abstenir, arguant que les coûts sont supérieurs à la commodité.
Le message central est clair : le respect de la réalité reste inégalé. La nouveauté de l’IA s’estompe, laissant derrière elle un brutal rappel que la créativité humaine et la pensée critique sont irremplaçables.